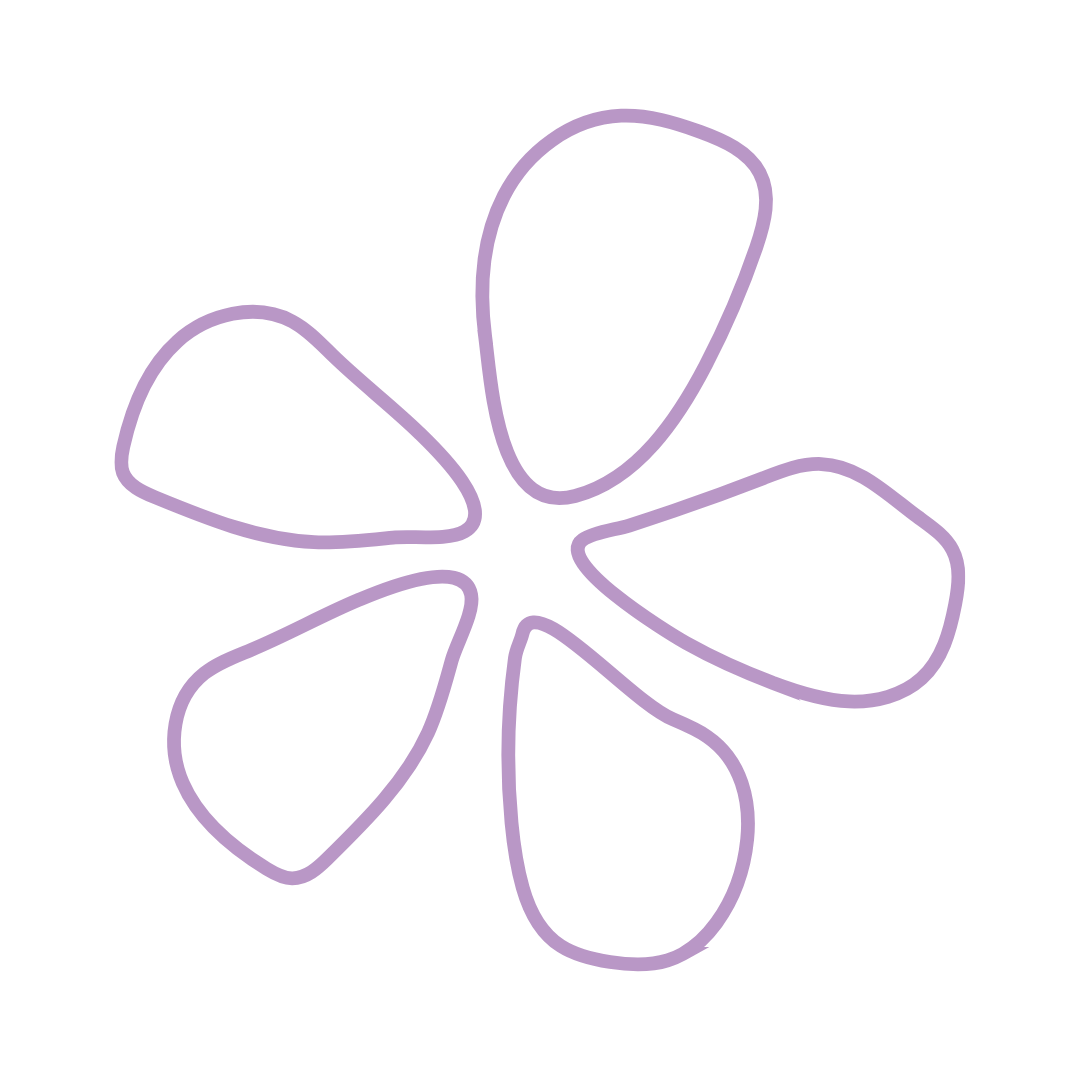Après une violence sexiste ou sexuelle (VSS), certaines personnes développent un trouble de stress post-traumatique, ou TSPT. Tandis que certaines violences laissent des traces visibles, d’autres restent invisibles, mais leurs effets sont tout aussi profonds. Ce trouble se manifeste parfois des semaines, des mois, voire des années après l’événement.
Mais qu’est-ce qu’un trouble exactement ? Et comment différencier un mal-être passager d’un trouble plus profond lié à un traumatisme ?
Qu’est-ce qu’un trouble de stress post-traumatique et comment apparaît-il ?
Les violences sexistes et sexuelles peuvent avoir des conséquences psychotraumatiques profondes et durables.
Leur impact sur le psychisme repose sur des mécanismes biologiques complexes – notamment la sidération psychique, la dissociation traumatique et la mémoire traumatique et peut se manifester par des troubles mentaux variés, allant du trouble de stress post-traumatique simple (TSPT) au trouble de stress post-traumatique complexe (TSPT-C).
Lorsqu’un individu est confronté à une situation de danger extrême, le cerveau active une réponse de stress intense impliquant principalement trois structures : l’amygdale, le cortex pré-frontal et l’hippocampe.
Dans une situation de violence, perçue comme une menace insurmontable, ce mécanisme est déréglé, provoquant des réactions dysfonctionnelles qui perdurent au-delà de l’événement traumatique.
Ces dérèglements sont à l’origine du trouble de stress post-traumatique (TSPT).
Le trouble de stress post-traumatique : une réaction durable au traumatisme
Le TSPT est un trouble mental, reconnu dans les classifications médicales internationales (DSM-5 et CIM-11). Il peut survenir après un événement particulièrement choquant ou violent. Contrairement à une « mauvaise passe » ou un simple souvenir douloureux, il s’agit d’un ensemble de symptômes intenses et persistants qui affectent le quotidien. Ces réactions ne sont ni exagérées ni irrationnelles : elles sont directement liées à la manière dont le cerveau a enregistré l’événement comme une menace insurmontable.
Le TSPT « simple » est généralement déclenché par un événement isolé et unique, comme une agression. Il peut apparaître rapidement après les faits, ou plus tard, parfois plusieurs semaines ou mois après.
Les symptômes sont regroupés en quatre grandes catégories :
- Les symptômes d’intrusion (ou reviviscences) : cauchemars, flashbacks, pensées envahissantes. Certaines sensations, images ou bruits peuvent réactiver malgré soi le souvenir de l’événement.
- Les symptômes d’évitement : la personne tente inconsciemment de se protéger, en évitant certains lieux, personnes ou conversations liées au traumatisme.
- Les symptômes d’hyper éveil (ou hypervigilance) : le corps reste en alerte constante. Cela peut provoquer de l’hypervigilance, de l’irritabilité, des troubles du sommeil ou des difficultés de concentration.
- Les symptômes d’hypo éveil : moins reconnus, mais à l’inverse, certaines personnes peuvent se sentir émotionnellement engourdies, épuisées, ou coupées de leurs sensations.
Le TSPT simple peut être particulièrement éprouvant, mais il peut aussi faire l’objet d’une prise en charge adaptée. Des thérapies spécialisées existent et permettent, avec le temps, d’apaiser les symptômes et de retrouver un équilibre.
Le TSPT complexe
Depuis 2019, la CIM-11 reconnaît une forme plus sévère du TSPT, appelée Trouble de Stress Post-Traumatique Complexe (TSPT-C).
Ce diagnostic, reconnu par l’Organisation mondiale de la santé (CIM-11), intègre deux composantes :
- La première, quantitative, implique la répétition des traumas ;
- La seconde, qualitative, touche à la structuration de l’individu.
C’est notamment le cas des violences infantiles (violences incestueuses, harcèlement, …) ou des violences conjugales.
En plus des symptômes du TSPT « simple », cette forme complexe s’accompagne de perturbations affectives, des troubles de l’identité, et des difficultés interpersonnelles et sociales
- Des perturbations affectives
Certaines personnes éprouvent des difficultés à gérer leurs émotions. Cela peut se traduire par des accès de colère, des crises de larmes, une instabilité émotionnelle, ou à l’inverse, une impression de vide intérieur. Il arrive aussi que l’on ressente une honte persistante, une culpabilité excessive, ou l’idée d’être « cassé·e », « abîmé·e », « impur·e ». Ce mal-être peut s’accompagner d’une perte de plaisir, d’envies, ou d’espoir pour l’avenir.
- Des troubles de l’identité
Le TSPT complexe peut affecter le rapport à soi. Certaines personnes se sentent déconnectées de qui elles sont, ont du mal à se projeter dans l’avenir, ou se perçoivent comme fondamentalement mauvaises, indignes de respect ou d’amour. Le regard sur le corps peut aussi être affecté, avec du rejet de soi, des troubles alimentaires ou des comportements auto-agressifs.
- Des difficultés interpersonnelles et sociales
Après des violences répétées, faire confiance peut devenir difficile. Il peut y avoir une grande méfiance envers les autres, de l’isolement, ou au contraire un besoin très fort d’être rassuré·e. Il arrive que certaines personnes se retrouvent dans des relations instables, ou aient du mal à poser des limites dans leurs liens avec les autres.
Ces effets ne sont ni rares, ni irréversibles, ils traduisent l’impact profond que peuvent avoir des violences répétées.
N.B. : La CIM (classification médicale de l’Organisation Mondiale de la Santé) reconnaît qu’en raison de leur développement neurologique encore immature et de leur dépendance aux adultes, les enfants victimes de violences sont particulièrement susceptibles de présenter des réactions de sidération traumatique. Cette vulnérabilité accrue favorise des mécanismes de dissociation plus marqués et durables. Enfin, certain·es auteur·es scientifiques parlent de ‘traumatisme développemental’, pour souligner l’impact durable des traumatismes répétés sur le développement encore non acquis de l’enfant.
Que faire en cas de trouble de stress post-traumatique ?
Il existe des thérapies préconisées pour la prise en charge du psychotraumatisme. Ces approches sont reconnues, structurées, et pratiquées par des professionnel·les spécifiquement formé·es :
- La TCC-CT (Thérapie cognitivo-comportementale centrée trauma) : thérapie visant à identifier et modifier les pensées et comportements liés au traumatisme pour réduire la détresse.
- L’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing ou « désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires ») – reconnue par l’OMS en 2013 et la Haute Autorité de Santé depuis 2007 : technique utilisant des stimulations bilatérales (mouvements oculaires, sons ou tapotements) pour retraiter les souvenirs traumatiques.
- TPC (Thérapie de Processing Cognitif) : approche structurée pour comprendre et reconfigurer les croyances négatives issues du traumatisme.
- EP (Exposition Prolongée) : exposition graduelle et prolongée aux souvenirs ou situations évités afin de diminuer l’anxiété et la détresse.
Selon ta situation, d’autres types de soutien peuvent être envisagés en complément :
- Un accompagnement psychologique, thérapeutique ou par un·e sexologue ;
- Une prise en charge médicale ou paramédicale ;
- Un suivi psychiatrique – dans certains cas ;
- Des approches complémentaires (yoga, méditation, art-thérapie, etc.) peuvent aussi aider à reprendre contact avec ton corps et tes émotions.
Questions fréquentes
Est-ce que le TSPT peut apparaître longtemps après les faits ?
Oui. Certaines personnes développent un TSPT immédiatement après l’événement. Pour d’autres, les symptômes peuvent apparaître des semaines, voire des mois plus tard. Ce décalage ne remet jamais en question la gravité de ce qui a été vécu.
Est-ce que c’est normal d’avoir des flashbacks même des mois après ?
Oui. Les flashbacks, tout comme les cauchemars ou les réactions de panique, sont des symptômes fréquents du TSPT. Même longtemps après les faits, ton cerveau peut réagir comme si le danger était toujours là. Ces réactions peuvent diminuer voire disparaitre avec un accompagnement adapté.
Est-ce que le TSPT se soigne ?
Le TSPT peut être pris en charge avec des thérapies spécialisées. Certaines approches sont reconnues pour aider à traiter les psychotraumas comme l’EMDR, la TCC, le brainspotting et l’ICV. Le chemin est parfois long, mais il est possible d’apaiser les symptômes et de retrouver un équilibre.
Quelle est la différence entre un TSPT et une “mauvaise passe” ?
Une “mauvaise passe” peut être liée à une période difficile, mais elle ne s’installe pas dans la durée. Le TSPT, lui, est un trouble reconnu médicalement. Il s’accompagne de symptômes persistants (flashbacks, évitement, hypervigilance, etc.) qui impactent fortement la vie quotidienne.
Est-ce que les enfants peuvent guérir d’un trauma ?
Oui, avec un accompagnement adapté. Les enfants sont particulièrement vulnérables aux effets du traumatisme, mais ils ont aussi une grande capacité de résilience. Une prise en charge précoce et adaptée permet souvent d’apaiser les symptômes et de prévenir des troubles plus durables.
Comment trouver un·e psy adapté·e ?
Pour traiter les TSPT, il faut absolument consulter des psychologues spécifiquement formé·es aux psychotraumatismes et aux méthodes cliniques préconisées telles que l’EMDR, la TCC, le brainspotting ou encore l’ICV.
Sur Mauve, tu peux trouver des professionnel·les de santé mentale formé·es aux violences sexistes et sexuelles. Tu peux aussi trouver des initiatives de pair-aidance, proposant des formes de thérapies douces.
Quels sont les 3 grands symptômes du stress post-traumatique ?
Les trois grands types de symptômes du TSPT sont :
- Les symptômes d’intrusion (flashbacks, cauchemars, pensées envahissantes)
- Les symptômes d’évitement (refus de parler des faits, évitement des lieux ou personnes liés au traumatisme)
- Les symptômes d’hyper ou d’hypo éveil (hypervigilance, irritabilité, ou au contraire engourdissement, fatigue, détachement)