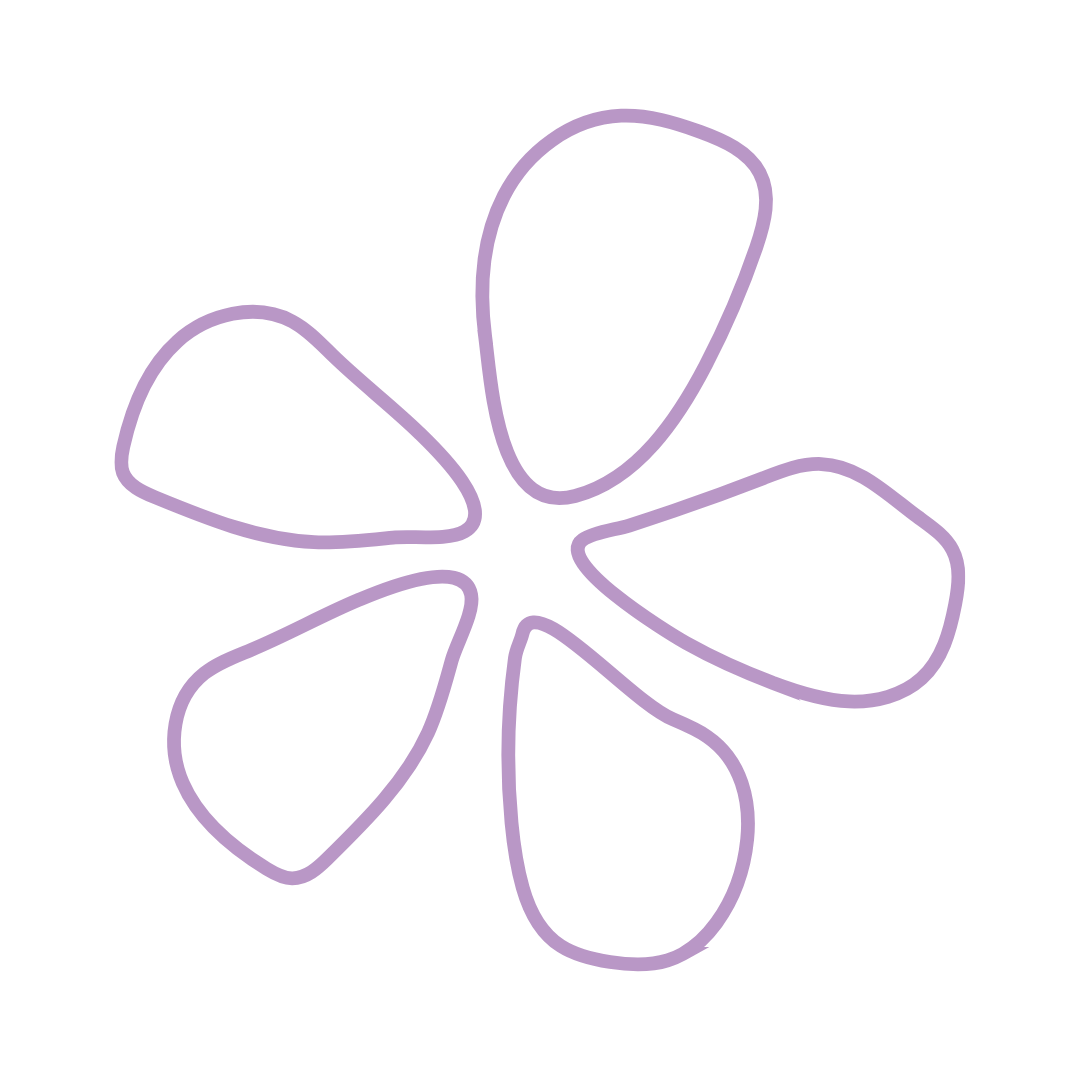Comprendre les violences sexistes et sexuelles, c’est aussi s’interroger sur ce qui les rend possibles, ce qui les banalise et ce qui les perpétue. Derrière les actes de violence, il y a des mécanismes plus profonds qui s’ancrent dans notre manière de percevoir les genres, de répartir les rôles, et de transmettre des normes.
Comprendre l’origine : définitions préalables sur le sexe et le genre
Qu’est-ce que le sexe ?
Le terme sexe fait référence aux caractéristiques biologiques et physiologiques de l’individu. Il n’y a qu’une seule manière de définir le sexe en biologie : la caractérisation des cellules sexuelles, les gamètes. Selon la définition scientifique, les individus de sexe féminin (femelles) produisent des ovules, tandis que ceux de sexe masculin (mâles) produisent des spermatozoïdes (Biologie du développement, Karsenty & Pralong, 2018).
On utilise aussi parfois d’autres critères comme les chromosomes, les hormones ou les organes génitaux pour déterminer le sexe, même si ces éléments peuvent varier et ne sont pas toujours de bons indicateurs.
Sur la base de ces critères, un sexe est assigné à chaque individu à sa naissance et mentionné sur son état civil. Pourtant, il existe une diversité importante de corps et de caractéristiques biologiques. Certaines personnes, appelées intersexes, présentent des variations sexuelles qui ne correspondent pas aux normes traditionnelles. Elles représenteraient au moins 1,7 % de la population mondiale (Sexing the Body, Anne Fausto-Sterling (biologiste américaine), 2000).
Qu’est-ce que le genre ?
Le genre fait référence aux rôles, comportements et attentes socialement construits qui sont attribués aux individus en fonction de leur sexe.
Ces rôles ne sont pas universels : ils varient selon les époques et les cultures. Par exemple, au XVIIe siècle, les hommes portaient des talons hauts, symboles de pouvoir et de statut social.
Des chercheur·ses, à l’instar de Margaret Mead ont aussi montré que dans certaines sociétés, les rôles dits “féminins” ou “masculins” n’existent pas ou sont inversés par rapport à ce qu’on connaît en Occident (Sex and Temperament in Three Primitive Societies, Margaret Mead, 1935).
Le genre est donc un ensemble de codes appris et transmis, qui influencent dès l’enfance la façon dont on se comporte, dont on s’habille, ou dont on est perçu·e.
Comprendre l’origine : les fondements des inégalités sociales
Les stéréotypes
Les stéréotypes sont des croyances partagées dans la société qui portent sur les caractéristiques d’une personne appartenant à un groupe. On attribue à une personne des traits simplement parce qu’elle appartient à un certain groupe.
Ce sont des idées toutes faites, qu’on apprend dès l’enfance, souvent à travers les jouets, les films, la publicité, l’école… Elles peuvent être positives ou négatives, mais elles restent réductrices, et varient selon les cultures ou les époques.
Par exemple : “Les filles sont douces et gentilles”.
Les préjugés
Lorsqu’un stéréotype est accompagné d’un jugement défavorable ou d’une émotion négative, on parle de préjugé.
Les préjugés sont des opinions personnelles basées sur des généralisations erronées, qui ont trait à l’émotion et à l’affect de chacun, et qui peuvent être conscients ou inconscients.
Par exemple : “Parce qu’elles sont douces et gentilles, les filles ne peuvent pas occuper de postes à responsabilité”
Les discriminations
Lorsque les préjugés entraînent des comportements négatifs à l’égard d’une personne basée sur son appartenance à un groupe, ils deviennent de la discrimination.
D’après l’article 225-1 du Code pénal français, la discrimination est définie comme : “toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée.”
Cela peut être un refus d’emploi, un accès limité à un logement, ou toute autre forme d’exclusion.
En France, la loi interdit les discriminations fondées, entre autres, sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’origine ou le handicap.
Par exemple : « Je ne vais pas engager une femme comme directrice car elle sera trop gentille. »
Des constructions sociales genrées aux violences sexistes et sexuelles
Les constructions sociales genrées
Les constructions sociales genrées désignent l’ensemble des normes, attentes et rôles que la société associe aux individus en fonction de leur sexe assigné à la naissance. Elles sont apprises dès l’enfance, transmises par l’éducation, la famille, les médias, la culture, les jouets etc.
Par exemple, on attend souvent des garçons qu’ils soient forts, compétitifs et indépendants, et des filles qu’elles soient douces, empathiques et valorisées pour leur apparence. Ces attentes peuvent sembler anodines, mais elles influencent les comportements, les choix de vie, et les rapports entre les individus.
Elles sont fondées sur des stéréotypes et peuvent conduire à des préjugés voire à des discriminations et donc créer des inégalités très concrètes.
La hiérarchisation des genres
Ces constructions sociales s’inscrivent dans un système où certains comportements ou qualités (généralement associés aux hommes) sont valorisés, tandis que d’autres (souvent associés aux femmes) sont dévalorisés. C’est ce qu’on appelle la hiérarchisation des genres.
Par exemple, la force et l’autorité sont souvent perçues comme plus légitimes que l’écoute ou la sensibilité dans les lieux de pouvoir (comme au travail).
Cette hiérarchie participe à la domination masculine et crée un climat où certaines formes de violence peuvent être minimisées, voire tolérées. En effet, 93% de la population française constate des inégalités de traitement entre les hommes et les femmes en 2022.
La pyramide des violences sexistes et sexuelles
Les constructions sociales genrées et la hiérarchisation des genres créent un terrain favorable à la banalisation de certains comportements sexistes. C’est ce cadre social et culturel qui permet aux violences de s’installer progressivement, souvent sans être perçues comme telles au départ.
Pour mieux comprendre ce mécanisme, la pyramide des violences sexuelles, développée par l’Université d’Alberta, est un outil précieux. Elle illustre comment nos croyances et attitudes fondamentales (constructions sociales) à la base directement liées à des systèmes d’inégalités qui déshumanisent et dévalorisent certaines personnes, tout en conférant des privilèges à d’autres (hiérarchisation des genres) contribuent à créer un environnement dans lequel les violences sexuelles peuvent perdurer.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que la culture du viol ?
La culture du viol désigne un ensemble de croyances, de pratiques, de normes et de représentations sociales qui banalisent, minimisent ou tolèrent les violences sexuelles, tout en culpabilisant les victimes et en protégeant les agresseurs.
Qu’est-ce que la société patriarcale ?
La société patriarcale désigne un système social dans lequel les hommes détiennent une position dominante et la majorité du pouvoir dans les sphères politique, économique, sociale, familiale et symbolique. Ce modèle repose sur la domination masculine et la subordination des femmes, mais aussi sur des normes de genre qui hiérarchisent les individus en fonction de leur sexe, de leur identité ou de leur conformité aux rôles genrés.
Pourquoi dit-on que le genre est une construction sociale ?
Parce qu’il repose sur des rôles, attentes et comportements transmis par la société. Ils varient selon les époques et les cultures, et ne dépendent pas de critères biologiques.
Est-ce que les stéréotypes sont forcément négatifs ?
Pas toujours. Ils peuvent être positifs ou négatifs, par exemple le fait de dire que « Les femmes sont multitâches. », peut être considéré comme un stéréotype positif. Mais dans tous les cas, les stéréotypes sont réducteurs et influencent nos comportements et jugements, souvent de façon inconsciente.
Quelle est la différence entre stéréotype, préjugé et discrimination ?
- Stéréotype : croyance générale de la société à l’égard d’un groupe. Toutes les personnes de la société les connaissent même si chacun·e n’y adhère pas forcément personnellement ;
- Préjugé : opinion personnelle négative fondée sur ce stéréotype ;
- Discrimination : comportement ou action inégale fondée sur ce préjugé.
Pourquoi parle-t-on de hiérarchisation des genres ?
Parce que les rôles associés au masculin sont historiquement valorisés (force, autorité) dans les lieux de pouvoir. Au contraire, les rôles associés au féminin sont dévalorisés (émotion, douceur). Cela crée des inégalités structurelles.
En quoi les constructions sociales peuvent-elles mener aux violences ?
Elles définissent des normes genrées. Ces normes normalisent la domination masculine, banalisent le sexisme ordinaire et permettent une plus grande tolérance aux violences.
Que montre la pyramide des violences sexistes et sexuelles ?
Elle montre que les violences « les plus graves » (au sens pénal) s’appuient sur des comportements et des croyances plus banalisés. Comme par exemple, le sexisme, les blagues oppressives ou les stéréotypes.