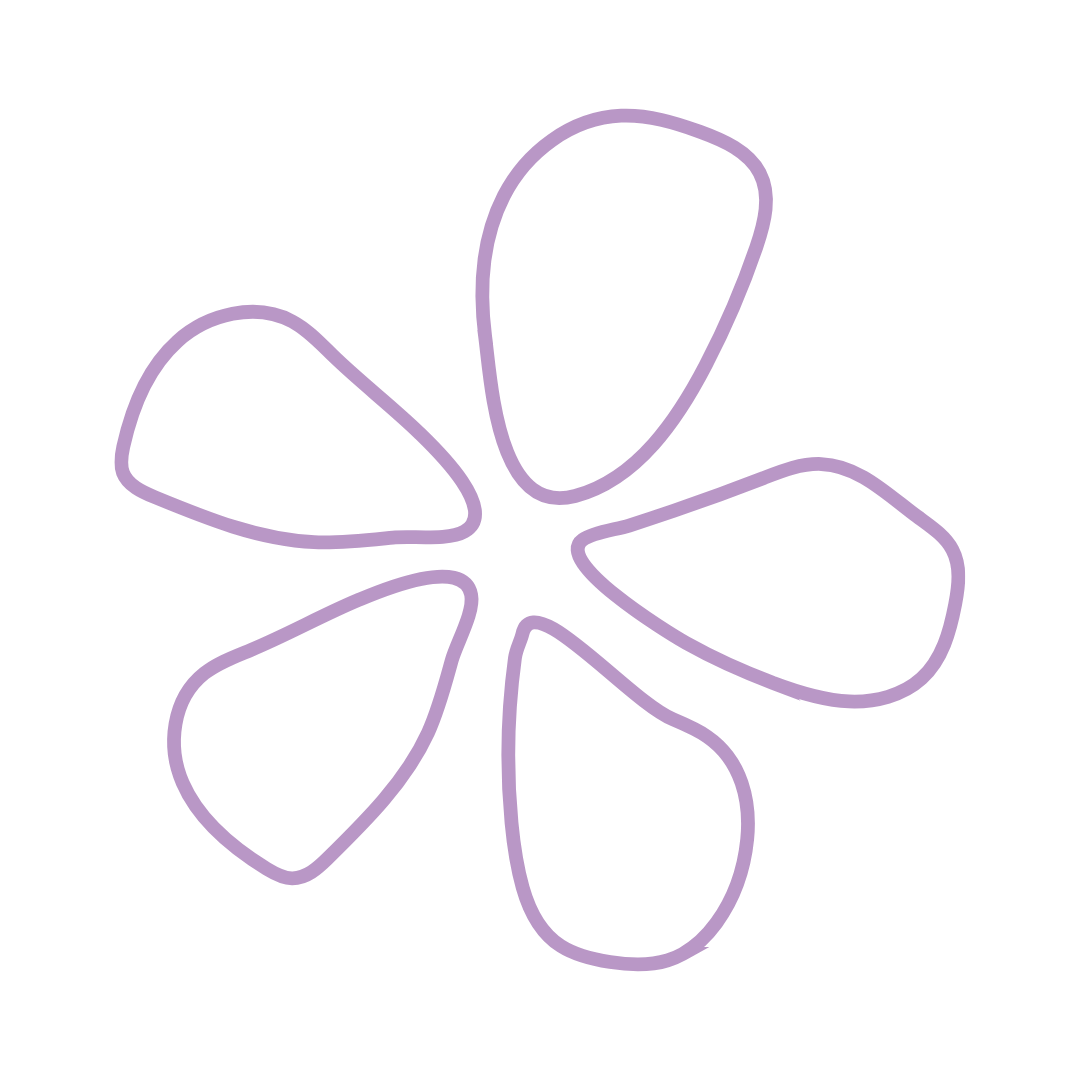Quand on a vécu des violences, comprendre les démarches possibles est essentiel. Quelle est la différence entre une plainte et une main courante ? À quoi servent-elles, comment les déposer, et dans quels cas ? Cet article t’aide à y voir plus clair.
Plainte ou main courante : quelle différence ?
Lorsqu’on vit ou qu’on est témoin d’un fait préoccupant, on peut se tourner vers une main courante ou un dépôt de plainte. Mais ces deux démarches n’ont ni le même objectif, ni les mêmes effets.
La main courante est une déclaration faite auprès de la police ou de la gendarmerie pour signaler un fait sans déposer plainte, c’est-à-dire sans demander l’ouverture d’une enquête. Elle laisse une trace officielle, utile par exemple pour documenter un début de harcèlement ou des conflits de voisinage. L’auteur·e des faits n’est pas informé·e ni convoqué·e, et la démarche est gratuite.
La plainte, elle, est une démarche juridique formelle qui permet de saisir la justice pour une infraction pénale. Elle déclenche une enquête, voire des poursuites, et éventuellement un procès. Elle est gratuite, possible même sans preuve directe, et les forces de l’ordre ont l’obligation de la recevoir.
💡 Tu peux toujours demander une copie de ta plainte ou de ta main courante. Et si tu changes d’avis, tu peux les retirer. Mais attention : retirer une plainte ne stoppe pas nécessairement les poursuites. C’est le Procureur qui décide.
Les cas où la main courante est interdite
Il est important de rappeler qu’il est impossible de déposer une main courante pour des faits de violences sexuelles, sexistes ou conjugales. Ces situations relèvent du droit pénal et nécessitent un signalement adapté, comme un dépôt de plainte ou une transmission directe au Procureur de la République.
Même sans dépôt de plainte, le Procureur peut décider d’ouvrir une enquête : il dispose seul de l’opportunité des poursuites.
Aucune main courante ne peut être enregistrée lorsqu’il y a suspicion d’infraction pénale, ce qui inclut les violences sexistes et sexuelles, les violences conjugales ou intrafamiliales. Et en cas de réitération des faits, une investigation pénale est automatiquement engagée.
Comment déposer une plainte ?
Déposer plainte, c’est signaler une infraction à la justice. Cela permet de déclencher une enquête et, selon les cas, des poursuites contre l’auteur·e des faits.
Où déposer plainte ?
La plainte peut être déposée :
- dans un commissariat de police ;
- dans une brigade de gendarmerie ;
- par courrier adressé au Procureur de la République du tribunal judiciaire compétent.
Le dépôt de plainte est gratuit. Les forces de l’ordre ne peuvent pas refuser de l’enregistrer, même sans preuve directe (article 15-3 du Code de procédure pénale).
Qui peut déposer plainte ?
Toute personne majeure peut porter plainte, pour elle-même ou en tant que représentant·e légal·e. Une personne mineure peut aussi déposer une plainte simple, mais devra être accompagnée d’un adulte (parent, tuteur, ou administrateur·rice ad hoc) pour une plainte avec constitution de partie civile.
En cas d’inceste :
- Si la personne victime est mineure, un parent ou tuteur peut effectuer la démarche de dépôt de plainte, soit en se rendant en commissariat ou gendarmerie, soit par courrier adressé au Procureur de la République. En cas d’urgence ou de danger immédiat, des mesures de protection peuvent être prises (hospitalisation, placement…).
- Si la personne victime est majeure, il est recommandé de réunir un maximum de preuves pour appuyer la plainte : récit détaillé, certificats médicaux, témoignages, carnet de santé, bulletins scolaires, photographies… Ces documents peuvent être confiés à un·e avocat·e.
Contre qui peut-on déposer plainte ?
- Une personne physique ;
- Une personne morale (entreprise, administration…) ;
- “Contre X” si l’auteur·e des faits est inconnu·e.
Comment se passe l’audition ?
Pendant l’audition, la personne victime peut être accompagnée par quelqu’un de son choix (avocat·e, proche, professionnel·le, intervenant·e social·e). Elle répond aux questions de l’enquêteur, peut fournir des preuves (messages, enregistrements, photos, certificats médicaux, témoignages…), et doit relire puis signer son procès-verbal.
👉 Il faut absolument repartir avec une copie de ton Procès-Verbal.
En fonction des faits, une évaluation des blessures peut être faite en Unité Médico-Judiciaire (UMJ) sur demande de l’enquêteur. Cela permet d’établir un certificat médical avec, si nécessaire, des jours d’incapacité totale de travail (ITT), même si la personne ne travaille pas.
Se faire accompagner dans sa démarche
Que tu choisisses de porter plainte ou que tu sois dans une situation où tu hésites encore, il est possible d’être accompagné·e à chaque étape.
Les avocat·es sont souvent les premier·es interlocuteur·trices dans ce parcours. Tu peux aussi te tourner vers des associations spécialisées, des juristes dans des structures comme les CIDFF (Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles), ou encore les intervenant·es sociaux·ales présent·es dans certains commissariats ou brigades.
Ces professionnel·les peuvent t’aider à comprendre tes droits, à préparer ton dépôt de plainte, à rassembler des documents utiles, ou simplement à avancer à ton rythme, en te sentant soutenu·e.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre une plainte et une main courante ?
La plainte est une démarche juridique pour signaler une infraction et ouvrir une enquête. La main courante sert simplement à consigner des faits, sans suite judiciaire automatique. Elle ne peut pas être utilisée dans les cas de violences sexistes, sexuelles ou conjugales.
Quelles sont les conséquences d’une main courante ?
Elle ne déclenche pas de procédure judiciaire, mais permet de laisser une trace écrite d’un événement. Cela peut être utile pour établir un historique si la situation évolue.
Quelle est la valeur d’une main courante ?
Elle peut servir de preuve indirecte si elle est bien datée et contextualisée, mais elle n’a pas la même valeur juridique qu’une plainte.
Est-ce qu’une main courante apparaît dans le casier judiciaire ?
Non. Une main courante n’est pas une condamnation, elle n’est donc pas inscrite dans le casier judiciaire.
Quel est l’intérêt de porter plainte ?
Porter plainte permet de signaler qu’une infraction a été commise, de déclencher une enquête et éventuellement d’engager des poursuites contre l’auteur·e. C’est aussi une étape importante pour être reconnu·e comme victime d’une infraction.
Quel est le délai maximum de traitement d’une plainte ?
Il n’y a pas de délai unique : le traitement peut prendre plusieurs mois, souvent plusieurs années selon la complexité de l’enquête et la nature des faits signalés.
La police peut-elle refuser d’enregistrer une main courante ?
Non, en principe. Mais si les faits relèvent d’une infraction pénale (comme une violence conjugale ou une violence sexuelle), la main courante est interdite et une plainte doit être enregistrée.
La police peut-elle refuser d’enregistrer une plainte ?
Non. L’article 15-3 du Code de procédure pénale interdit les forces de l’ordre de refuser d’enregistrer une plainte.
Puis-je annuler une main courante ?
Oui. Tu peux demander à la retirer auprès du commissariat ou de la gendarmerie où elle a été enregistrée.
Puis-je annuler une plainte ?
Oui. Mais cela ne suppose pas l’arrêt de l’enquête ou des poursuites. C’est le Procureur de la République qui en a la décision.