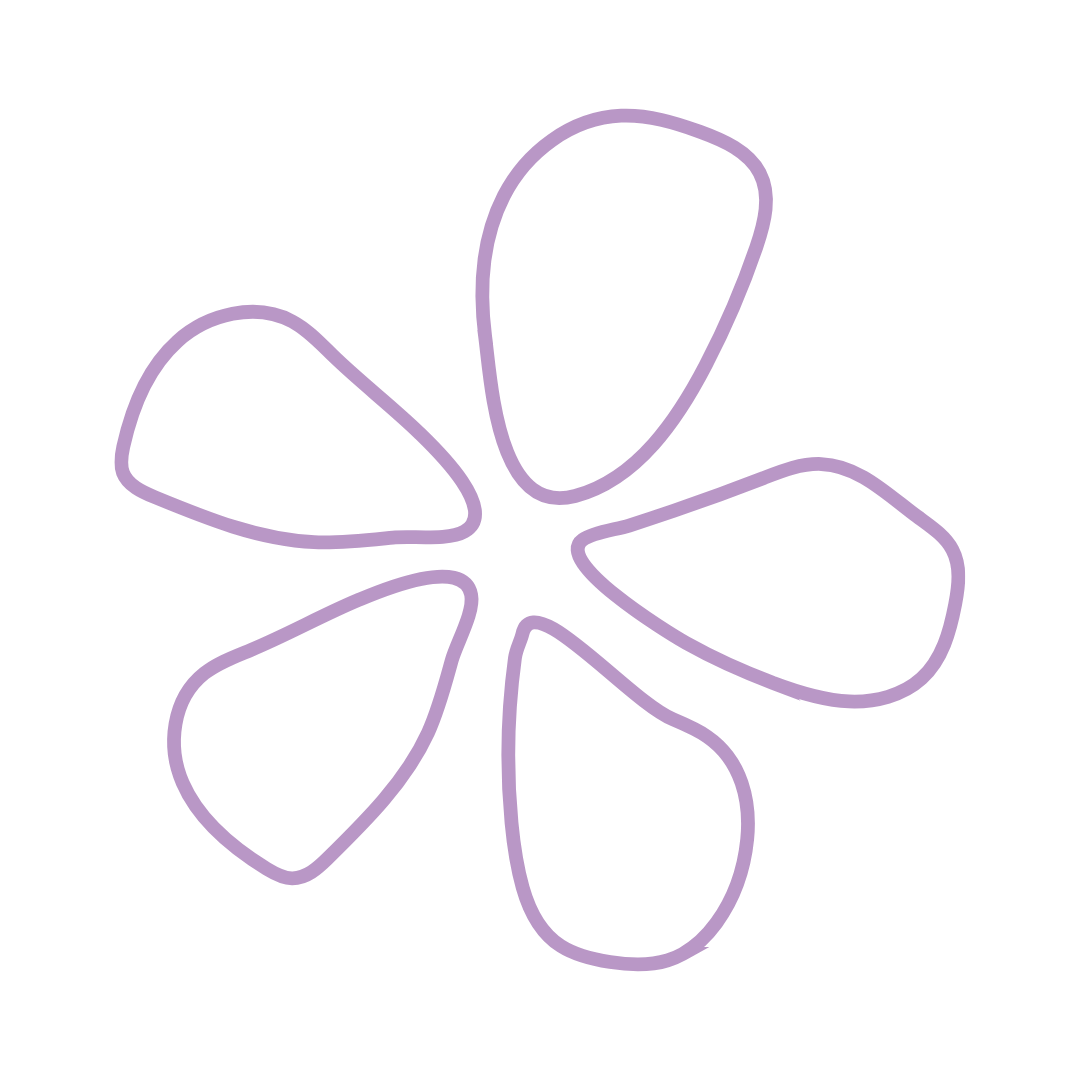Les violences sexistes et sexuelles peuvent concerner tout le monde. Mais selon le parcours, l’environnement ou la situation de vie, certaines personnes sont davantage exposées, ou rencontrent plus d’obstacles pour être protégées, entendues ou aidées.
Certaines de ces réalités sont reconnues dans le droit français : le Code pénal identifie plusieurs critères de vulnérabilité spécifique, qui peuvent modifier la qualification des faits ou aboutir à des circonstances aggravantes. D’autres personnes sont vulnérables en raison des discriminations qu’elles subissent et qui sont interdites par la loi.
Le sexe, le genre et l’orientation sexuelle
Les violences sexistes et sexuelles touchent toutes les sphères de la société, mais elles concernent majoritairement les femmes. En 2023, 85 % des victimes de violences sexuelles étaient des femmes.), et 9 femmes sur 10 déclarent avoir déjà subi une situation sexiste. Ces violences ne sont ni anecdotiques, ni isolées. Elles s’inscrivent dans un système plus large de domination et d’inégalités.
Les personnes LGBTQIA+ sont également confrontées à des formes de violences spécifiques souvent invisibilisées :
- Violences de conversion, rejet familial, harcèlement.
- Difficulté à porter plainte par peur d’être mal reçu·e.
- Violences conjugales peu reconnues dans les couples de même sexe.
Ce manque de reconnaissance favorise l’isolement, la minimisation des faits et un seuil de tolérance élevé face aux violences.
Leur vécu peut être multiple et difficile à nommer. Beaucoup hésitent à porter plainte, par peur d’être jugées ou mal accueillies. D’autres se heurtent à des structures inadaptées ou à un manque de compréhension de leur réalité. Dans les couples non hétérosexuels, par exemple, les violences conjugales restent souvent sous-estimées, alors même qu’elles existent tout autant.
Les discriminations répétées, les rejets ou le manque de reconnaissance peuvent aussi avoir des effets sur la santé mentale, l’estime de soi, ou le rapport au soin. Tout cela renforce la vulnérabilité, et rend la recherche d’aide encore plus complexe.
Sur la plateforme Mauve, il est possible de trouver des structures spécialisées pour l’accueil des personnes LGBTQIA+.
Le handicap
Quand une personne est en situation de handicap, le risque de subir des violences est souvent plus élevé. Les femmes en situation de handicap seraient quatre fois plus susceptibles d’être victimes de violences sexuelles.
Ce risque renforcé s’explique par plusieurs facteurs : une plus grande dépendance à un·e aidant·e ou à un·e proche, un isolement social, des difficultés à être cru·e ou à exprimer ce qui a été vécu. Certaines personnes n’ont tout simplement pas accès aux lieux d’écoute ou de soins. D’autres n’osent pas parler, par peur de ne pas être entendues, ou parce qu’elles n’ont jamais appris qu’elles avaient le droit de dire non.
La grossesse
Être enceinte, c’est un moment intense, parfois fragile. Pour certaines femmes, c’est aussi une période où les violences conjugales apparaissent ou s’aggravent. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) explique que 20 à 40 % des femmes victimes de violences conjugales disent que les violences ont commencé pendant la grossesse.
La grossesse peut réveiller des traumatismes passés, augmenter la dépendance financière ou affective, ou isoler davantage. Ce contexte peut renforcer l’emprise, compliquer la recherche d’aide, ou faire naître un sentiment d’impuissance. Et les conséquences peuvent être lourdes : pour la santé de la mère, pour celle de l’enfant, mais aussi pour le lien qui se construit.
L’origine, la langue et le statut administratif
Les personnes non françaises, immigrées, en situation irrégulière ou non-francophones font face à des obstacles supplémentaires lorsqu’elles sont victimes de violences :
- Dépendance administrative : certaines victimes craignent de signaler les par peur d’une expulsion ou d’un refus de renouvellement de titre de séjour
- Isolement linguistique et social : la barrière de la langue peut entraver l’accès aux soins, aux démarches juridiques et aux dispositifs d’aide
- Exploitation et précarité : les femmes sans ressources ou sans emploi sont souvent contraintes de rester sous l’emprise de leur agresseur
C’est pourquoi il est essentiel de renforcer l’accessibilité des dispositifs d’aide : proposer des informations claires et disponibles en plusieurs langues, mieux former les professionnel·les à l’accueil de personnes étrangères ou non-francophones, et garantir que personne ne soit dissuadé·e de demander de l’aide par peur d’être jugé·e ou sanctionné·e. Parce qu’aucun statut administratif, aucune barrière linguistique ne devrait empêcher une personne victime d’être protégée.
La précarité socio-économique
Quand on dépend financièrement de son agresseur, quand on n’a pas d’endroit où aller, quand on n’a pas accès à ses papiers ou à ses ressources, sortir de la violence devient encore plus difficile.
Les femmes sans domicile fixe, ou en situation de grande précarité, sont particulièrement exposées aux violences sexistes et sexuelles. Certaines subissent des violences dans la rue, dans des centres d’accueil, ou dans des logements d’urgence. D’autres ne peuvent pas faire valoir leurs droits, faute d’adresse stable ou de ressources suffisantes.
Dans ces situations, demander de l’aide devient encore plus difficile, alors même que le besoin est urgent. Quand l’insécurité fait partie du quotidien, il peut sembler impossible de chercher un lieu sûr ou de faire valoir ses droits.
L’âge
Les personnes âgées
Les personnes âgées victimes de violences sont encore peu visibles.
Lorsqu’elles dépendent physiquement ou psychologiquement d’un·e proche aidant·e ou d’un·e membre du personnel soignant, il peut leur être difficile de se protéger ou de parler. La violence sexuelle envers les seniors reste encore très taboue, ce qui renforce le silence et rend le repérage plus complexe.
Certaines personnes, en raison de troubles cognitifs ou d’un isolement marqué, peinent à témoigner ou à prouver les faits. Par ailleurs, les modes de communication actuels ne sont pas toujours adaptés : la difficulté à utiliser les outils numériques ou à trouver les bons contacts freine l’accès aux ressources. Enfin, l’isolement social renforce cette vulnérabilité, en limitant les soutiens possibles.
Les personnes mineures
Les mineur·es quant à eux sont considérés vulnérables en raison de leur développement physique, émotionnel et cognitif, ainsi que de leur dépendance vis-à-vis des adultes.
Cette vulnérabilité est officiellement prise en compte dans les dispositifs juridiques français, comme le rappelle l’article 388 du Code civil, qui définit un·e mineur·e comme toute personne âgée de moins de 18 ans. Mais au-delà du cadre légal, les mineur·es font souvent face à de nombreux freins lorsqu’ils ou elles subissent des violences.
Leurs mécanismes de compréhension et de protection sont encore en construction : il peut y avoir une forme de culpabilité, une grande difficulté à mettre des mots sur ce qui a été vécu, ou une peur de ne pas être cru·e. Les agresseur·es peuvent aussi exercer une emprise forte, en manipulant ou en menaçant. Beaucoup ne savent pas qu’ils ou elles ont le droit de porter plainte, seul·e ou accompagné·e d’un·e adulte de leur choix. Enfin, la peur des représailles, le manque d’écoute, ou l’absence d’autonomie rendent encore plus difficile l’accès à l’aide et à la reconnaissance de leur parole.
Questions fréquentes
Pourquoi parle-t-on de « vulnérabilités spécifiques » ?
On parle de vulnérabilités spécifiques car ces critères de vulnérabilité ou de discrimination sont reconnus dans le Code Pénal français. Certaines personnes, en raison de leur âge, de leur genre, de leur handicap, de leur précarité ou de leur situation administrative, peuvent être davantage exposées aux violences, ou rencontrer plus de difficultés pour être protégées, reconnues ou accompagnées.
Est-ce qu’être dans une situation de vulnérabilité signifie qu’on est faible ?
Non, ce n’est pas une question de faiblesse personnelle. La vulnérabilité dépend surtout du contexte, des inégalités sociales et des obstacles systémiques. Cela rend certaines personnes plus exposées ou moins protégées face aux violences.
Pourquoi les personnes LGBTQIA+ sont-elles plus souvent ciblées ?
Parce qu’elles sortent des normes imposées sur le genre et la l’orientation sexuelle. Elles subissent encore beaucoup de rejet, de discrimination ou de violences. Ces violences peuvent venir de la famille, de l’école, du travail ou de la société en général.
Qu’est-ce qui rend les personnes en situation de handicap plus à risque ?
La dépendance à un·e aidant·e, l’isolement, le manque d’accessibilité, ou encore le fait de ne pas être cru·e compliquent le repérage et la prise en charge des violences subies par les personnes en situation de handicap.
Qu’est-ce qui rend les personnes migrantes ou non-francophones plus à risque ?
Certaines personnes hésitent à demander de l’aide, par peur de perdre leur titre de séjour. La langue, l’absence de réseau ou la méconnaissance des droits peuvent aussi limiter l’accès aux soins ou à la justice.
Comment repérer les violences chez les personnes âgées ou isolées ?
C’est souvent difficile car les violences peuvent être silencieuses, dissimulées ou banalisées. Le tabou, la honte ou les troubles cognitifs compliquent la parole. Il faut être particulièrement attentif·ve aux signaux faibles.
Pourquoi les mineur·es ont-ils autant de mal à parler ?
Les enfants et adolescent·es sont souvent sous emprise, manipulé·es ou menacé·es. Ils et elles peuvent aussi se sentir coupables, avoir peur de ne pas être cru·es, ou ne pas savoir qu’ils ont le droit d’en parler ou de porter plainte. Fréquemment, les personnes mineures parlent mais ne sont pas écoutées par les personnes adultes.
Quelles solutions existent pour accompagner les personnes les plus exposées ?
Des associations, professionnel·les formé·es, numéros d’écoute et dispositifs spécialisés peuvent offrir un soutien adapté. Toutes les ressources sont à retrouver sur la plateforme Mauve.