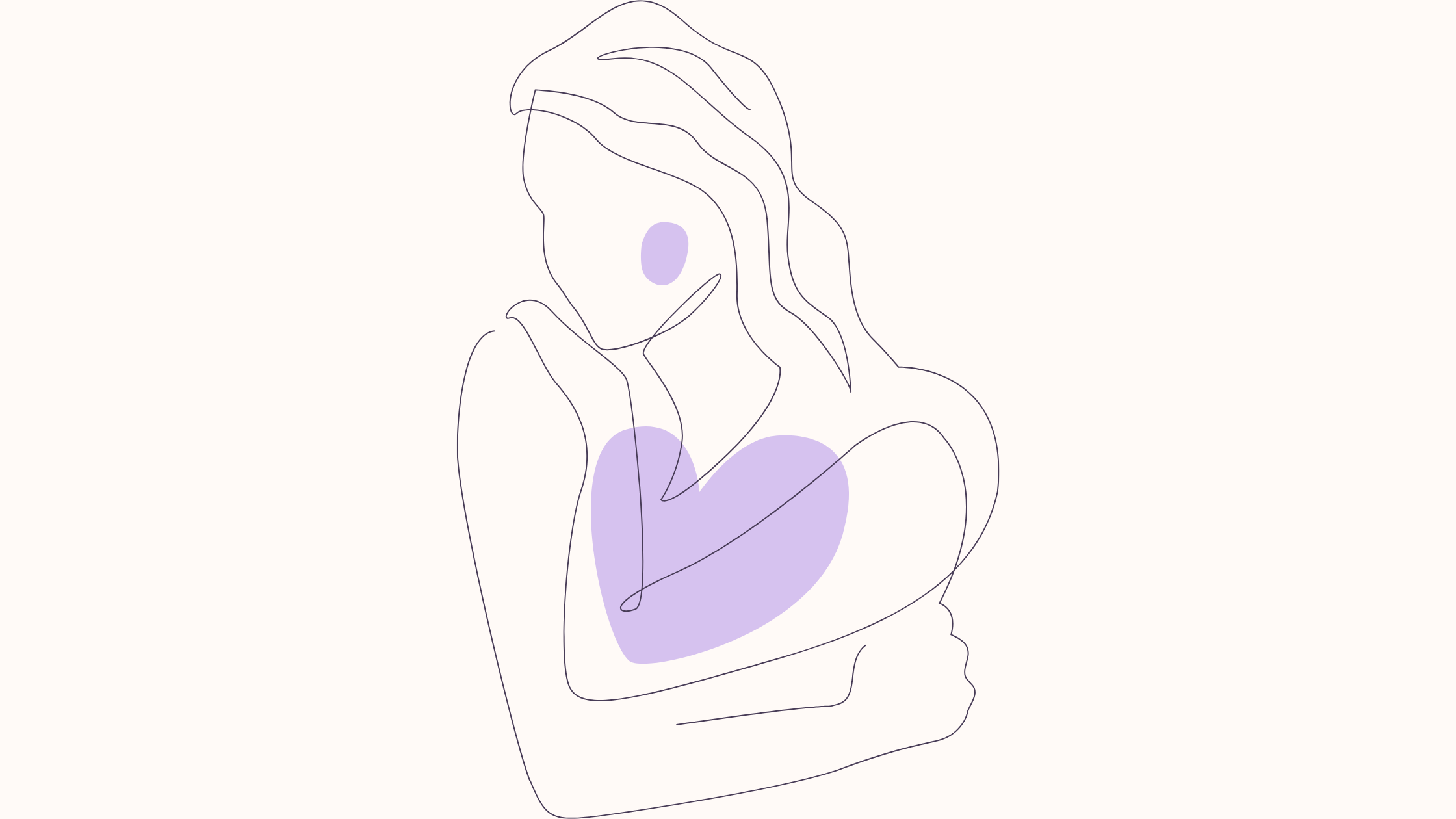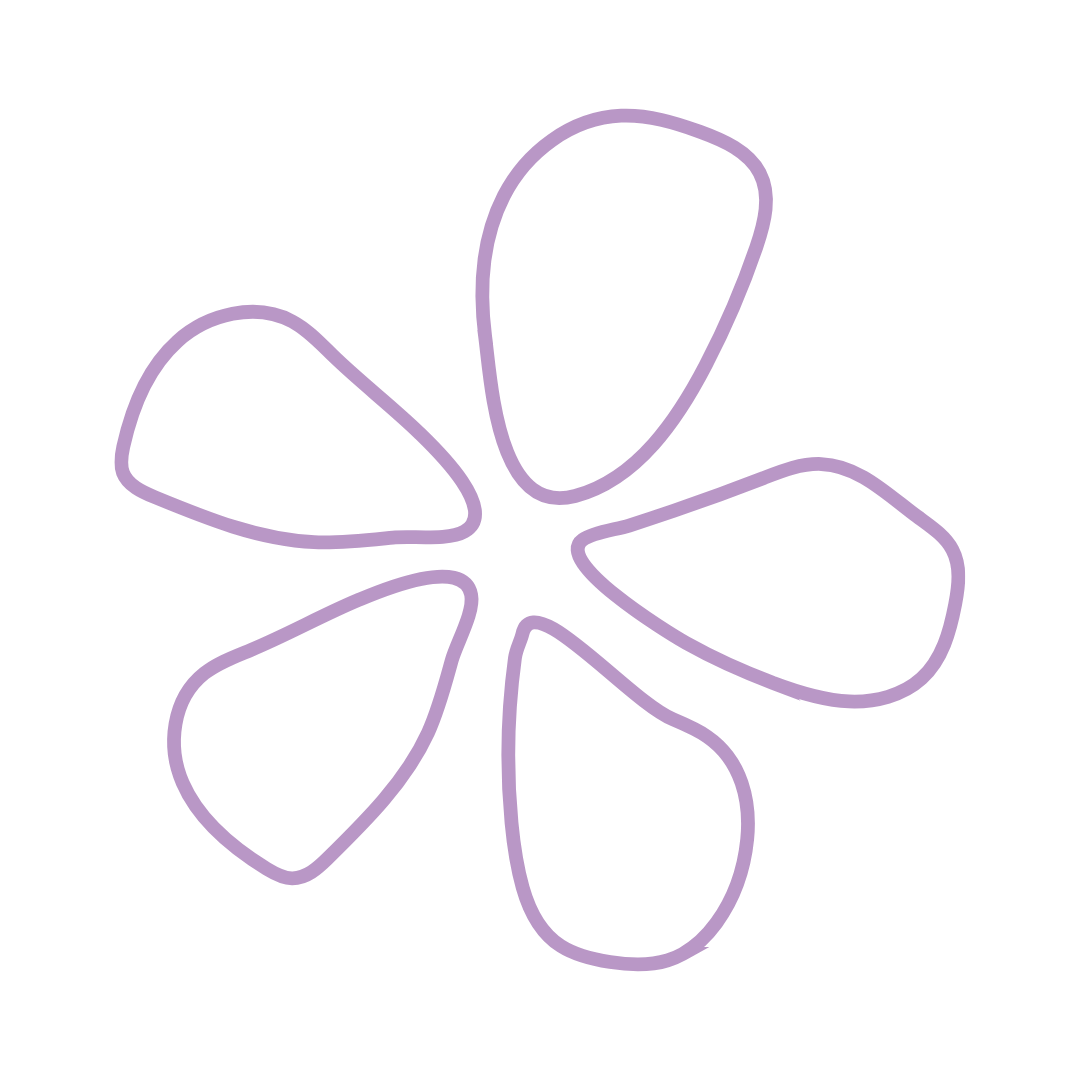Après avoir vécu des violences, comment retrouver un sentiment de sécurité ? Par où commencer lorsqu’on se sent isolé·e, épuisé·e, ou envahi·e par la culpabilité ?
Ces réactions sont normales et tu as le droit d’être écouté·e, soutenu·e, accompagné·e.
La reconstruction ne suit pas un chemin tout tracé. Elle peut prendre du temps, passer par des moments de doute ou de découragement. Mais elle est possible, en commençant par en parler et avec une prise en charge adaptée.
Rompre l’isolement : le premier pas vers la reconstruction
L’isolement est une conséquence fréquente des violences. Tu peux avoir l’impression que personne ne te comprend, que tu ne trouveras pas les mots ou que ce n’est “pas si grave”. Pourtant, parler à une personne de confiance est souvent le premier pas vers la reconstruction. Tu peux aussi passer par des ressources anonymes, ou des espaces d’expression comme ceux proposés sur Mauve. Sur la plateforme, tu trouveras des professionnel·les formé·es, disponibles pour t’écouter avec bienveillance, sans jugement.
Prendre conscience des conséquences et de tes besoins spécifiques
Il est important de reconnaître les impacts des violences, tant physiques que psychiques, ou encore sociaux.
Chaque personne réagit différemment. Les séquelles peuvent être visibles (fractures, blessures, hématomes, …) ou invisibles (douleurs chroniques, troubles digestifs, tensions corporelles, fatigue, troubles du sommeil, …).
Les conséquences varient selon les personnes, l’intensité des violences, leur durée, et les ressources disponibles. Elles peuvent s’inscrire sur le long terme et toucher plusieurs aspects de la vie quotidienne (la sexualité, les émotions, la concentration ou les relations aux autres).
Bien les repérer permet d’identifier les accompagnements les plus adaptés pour ta situation.
Trouver un accompagnement adapté pour la reconstruction
Accompagnement médical et paramédical
Les violences physiques et sexuelles peuvent provoquer des blessures, des douleurs, ou des troubles qui nécessitent une prise en charge médicale adaptée, afin d’évaluer ces effets et d’apporter les soins nécessaires, même sans traces apparentes.
Selon ta situation, tu peux recevoir des soins pour des blessures, obtenir un certificat médical avec ou sans jours d’ITT, ou encore bénéficier d’un dépistage et d’un traitement préventif du VIH si besoin. Il est aussi possible de recevoir une contraception d’urgence ou de faire un dépistage de la soumission chimique.
Un suivi médical est nécessaire si tu as besoin de prescriptions médicamenteuses, comme pour t’aider à dormir par exemple.
Un suivi gynécologique peut également être proposé, par exemple pour faire un frottis, un bilan post-agression, ou être accompagné·e dans le cas d’une grossesse. Certaines personnes préfèrent consulter un·e sage-femme ou un·e médecin généraliste.
Si tu ressens des douleurs chroniques ou des tensions corporelles liées au traumatisme, un suivi avec un·e kinésithérapeute ou un·e ostéopathe peut t’aider. Cela peut inclure une rééducation, un accompagnement des troubles digestifs ou musculo-squelettiques, ou encore des techniques douces pour soulager les tensions.
Accompagnement psychologique
Les violences peuvent laisser des traces profondes : anxiété, insomnies, isolement, perte de confiance en soi, difficultés relationnelles ou troubles intimes. Un accompagnement psychologique peut aider à apaiser ces effets et à retrouver un lien plus serein avec soi et avec les autres.
Certaines approches comme l’EMDR, la TCC (Thérapie Cognitivo-Comportementale), le brainspotting ou encore l’ICV (Intégration du Cycle de la Vie) sont particulièrement recommandées pour soigner les psychotraumatismes.
Dans certains cas, notamment en présence de troubles sévères comme des idées suicidaires ou un état dissociatif, un suivi psychiatrique avec un traitement peut être nécessaire.
Des formes de thérapies douces et complémentaires peuvent aussi enrichir ce parcours : certaines personnes trouvent un soulagement dans l’hypnose, la sophrologie, la méditation ou encore la phytothérapie, à condition d’être bien accompagné·e. Se reconnecter à son corps passe parfois par des pratiques comme le yoga, la danse-thérapie, le sport doux ou l’art-thérapie. D’autres choisissent des formes de soutien plus collectives, comme des groupes de parole ou la pair-aidance, pour sortir de l’isolement et se sentir compris·es.
Accompagnement juridique
Si tu souhaites porter plainte ou faire valoir tes droits, tu peux être accompagné·e par un·e avocat·e ou un·e juriste formé·e. Tu as le droit d’être écouté·e, d’avoir des explications claires, et de choisir à chaque étape ce qui est bon pour toi.
Accompagnement social
La reconstruction passe aussi par une stabilité dans le quotidien. Cela peut impliquer un relogement, des démarches administratives, des aides sociales, ou un soutien à la parentalité. Des professionnel·les, notamment des assistantes sociales, peuvent t’aider à y voir plus clair.
Tu peux retrouver notre article sur les aides sociales et financières en cas de violences conjugales.
Les obstacles qui peuvent freiner la reconstruction
Se reconstruire après des violences ne suit pas un chemin unique. Chacun·e avance à son rythme, mais il existe des repères, des protocoles et des accompagnements reconnus pour aider à retrouver un mieux-être.
Ce parcours peut néanmoins être freiné par des obstacles : la stigmatisation, le regard des autres, ou une honte intériorisée, nourrie par l’idée fausse de ne pas avoir “réagi comme il fallait”.
Il est normal d’avoir des hauts et des bas. Reprendre confiance, c’est aussi retrouver une forme d’autonomie : poser tes limites, reconnaître ce qui ne te respecte pas, dire non sans culpabilité.
Il est essentiel de s’entourer de professionnel·les formé·es, accéder à une information claire et à des lieux sûrs. L’important, c’est que tu sois écouté·e, respecté·e, et que tu puisses à ton rythme avancer dans ta reconstruction.
Questions fréquentes
Que faire quand un·e proche se confie sur des violences subies ?
Il faut d’abord créer un cadre de confiance, dans un lieu calme et privé. Montrez-lui que vous la croyez et que vous êtes là pour l’écouter, sans la juger. Posez des questions ouvertes en respectant son rythme, sans la forcer à parler. Assurez-lui la confidentialité et dites-lui qu’elle peut vous en reparler quand elle veut.
Et si je me sens encore coupable ?
C’est une réaction fréquente. Beaucoup de personnes victimes intériorisent la culpabilité, surtout si elles n’ont pas été crues ou soutenues. Pourtant, tu n’es pas responsable de ce que tu as subi. La faute revient toujours à l’auteur·trice des violences. Parler de ce que tu ressens avec un·e professionnel·le bienveillant·e peut t’aider à alléger ce poids.
Et si je n’arrive pas à en parler ?
Mettre des mots peut prendre du temps. Tu peux commencer par écrire, ou consulter une ressource en ligne, ou simplement lire des témoignages. Tu peux aussi parler à une personne neutre, formée à ces situations, comme un·e professionnel·le trouvé·e via Mauve.
Est-ce que c’est trop tard pour demander de l’aide ?
Non, il n’est jamais trop tard. Que les faits soient récents ou anciens, tu as le droit d’être écouté·e et accompagné·e. Le traumatisme ne disparaît pas avec le temps. Et la reconstruction peut commencer même des années après.
Et si mon corps a changé depuis les violences ?
Les violences peuvent laisser des traces visibles ou invisibles. Tu peux ressentir un mal-être, des douleurs, ou un sentiment d’étrangeté vis-à-vis de ton corps. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas te réapproprier ton corps : avec le bon accompagnement, tu peux progressivement retrouver une sensation de sécurité et de bienveillance envers toi-même.
Est-ce qu’un·e professionnel·le peut m’aider même si je ne veux pas porter plainte ?
Oui. Porter plainte n’est jamais une obligation pour accéder à un soutien médical, psychologique, juridique ou social. Tu as le droit de recevoir de l’aide, même sans démarche judiciaire. Sur Mauve, tous les professionnel·les référencé·es sont formé·es pour accueillir ton vécu sans condition.
Combien de temps faut-il pour guérir d’une violence ?
Il n’y a pas de durée “normale” ou standard. La guérison dépend de plusieurs choses : la nature des violences subies, leur durée, les séquelles laissées (physiques ou psychiques), le soutien que tu reçois, ton environnement, et ton propre rythme.
Certaines personnes vont mieux en quelques semaines, d’autres ont besoin de mois, parfois d’années. Il n’y a pas d’échec à prendre son temps.
Ce qui compte, c’est d’avancer comme tu peux, avec les bons soutiens : ce n’est jamais trop tard pour commencer à aller mieux.
Est-ce que je peux utiliser Mauve si je ne suis pas sûre de ce que j’ai vécu ?
Oui. Tu n’as pas besoin d’avoir un “diagnostic” pour consulter Mauve. Si tu te poses des questions, si tu ressens un mal-être ou un doute, tu as le droit de chercher de l’aide. Les ressources sont là pour t’aider à mieux comprendre ta situation.
Est-ce que les professionnel·les sur Mauve sont formé·es ?
Oui. Les professionnel·les référencé·es sur la plateforme sont formé·es aux enjeux des violences sexistes et sexuelles grâce à une plateforme de e-learning et des outils facilement utilisables en consultation.
Et si je ne sais pas par où commencer ?
C’est normal. Tu peux commencer doucement, en lisant des ressources informatives. Tu n’as pas à tout faire en une fois. Mauve est là pour t’accompagner, étape par étape.